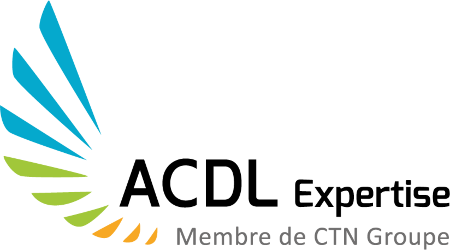Prélèvement à la source: quels sont les taux qui peuvent s’appliquer?
À partir du 1er janvier 2019, une partie de l’impôt du contribuable sera prélevé sur son salaire. Le montant de ce prélèvement est déterminé à partir d’un taux d’imposition multiplié par une assiette. Plusieurs taux sont susceptibles de s’appliquer.
En principe, c’est le taux d’imposition du foyer fiscal qui s’applique. Appelé « taux de droit commun » ou « taux personnalisé », il est calculé par l’administration fiscale sur la base des revenus déclarés lors de la dernière déclaration d’IR.
Le contribuable marié ou pacsé, soumis à une imposition commune, peut toutefois opter pour un taux individualisé. Il s’agit d’une simple répartition différente du paiement de l’impôt entre les conjoints sur la base de leurs revenus respectifs. Cette option n’a donc aucune d’incidence sur le montant total d’impôt qui est dû par le couple.
Pouvoir opter pour le taux « neutre »
Un taux « non personnalisé » ou « neutre » sera appliqué si l’administration fiscale n’est pas en mesure de communiquer un taux au collecteur, par exemple si le contribuable déclare ses revenus pour la première fois, ou qu’il a changé d’emploi en cours d’année. Le salarié peut également opter pour ce taux neutre. Il est déterminé à partir d’une grille de taux et dépend de la base mensuelle de sa rémunération.
Faut-il utiliser ses heures de DIF avant la fin de l’année 2018?
À compter du 1er janvier 2019, le fonctionnement du compte personnel de formation (CPF) sera modifié, notamment les heures acquises par les salariés seront converties en euros. Dans ce cadre, se pose à nouveau la question du sort des heures de DIF (droit individuel à la formation).
À l’origine, les salariés acquéraient des heures de DIF gérées par l’employeur. Ce dispositif ayant été remplacé par le CPF au 1er janvier 2015, les heures de DIF ont dû être transférées dans celui-ci. À cet effet, les employeurs devaient remettre à chaque salarié une attestation précisant le nombre d’heures de DIF acquises et non utilisée au 31 décembre 2014, afin de leur permettre de les enregistrer sur leur CPF.
Actuellement, le CPF est accessible sur le site www.moncompteactivite.gouv.fr. Lorsqu’il ne l’a jamais été, il est encore possible de l’activer en se munissant de son numéro de sécurité sociale.
Travail dissimulé et obligation de vigilance: attention aux sanctions!
Si une entreprise coupable de travail dissimulé encourt des sanctions administratives et pénales, le risque existe également quand elle emploie des sous-traitants.
Pour une entreprise, faire appel à un prestataire ou un sous-traitant, même de manière occasionnelle n’est pas anodin. Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, tout donneur d’ordre est en effet tenu de s’assurer que ses partenaires respectent les règles de déclarations et de paiements de leurs cotisations, au risque sinon de se voir condamner à de lourdes sanctions.
Des formalités à respecter
Les entreprises sont tenues à un devoir de vigilance vis-à-vis de leurs prestataires, dès lors que le contrat qui les lie atteint un montant global de 5000 € hors taxe, et même si la prestation fait l’objet de différentes factures d’un montant inférieur. Le donneur d’ordre doit, pour s’acquitter de ses obligations, demander à son prestataire de lui fournir un document attestant de son immatriculation, ainsi qu’une attestation de vigilance, qu’il doit obtenir auprès de l’Urssaf.
Cybermenaces 2019: 4 tendances à surveiller
Cibles privilégiées des pirates, les entreprises doivent prendre conscience de l’importance de se protéger pour éviter des pertes financières et une dégradation de leur image. Le risque cyber est difficile à gérer car les attaques des pirates évoluent. Tour d’horizon des prochaines cybermenaces.
Cybermenaces 2019 tendance n°1 : les attaques de rançonlogiciels en baisse
L’année 2017 a été marquée par les attaques WannaCry et NotPetya qui ont eu une ampleur mondiale. Et les PME n’ont pas été épargnées, en 2017 50 000 d’entre elles ont subi une cyberattaque selon la Confédération des PME. En 2018, la menace reste active avec Gandgrab et SamSam. Pourtant les attaques de rançonlogiciels ont baissé de 30% entre 2016-2017 et 2017-2018 selon le dernier rapport Kapersky Security Network de l’entreprise de cybersécurité Kapersky Lab. En 2019, le nombre d’attaques de rançonlogiciels devrait continuer à baisser mais elles seront plus ciblées. La vigilance est donc toujours de mise.
Période creuse: l’activité partielle, une solution?
Afin d’éviter les licenciements économiques, une entreprise qui traverse une mauvaise passe peut opter pour l’activité partielle. Décryptage…
Aucune entreprise n’est à l’abri de difficultés passagères. Mais quand les commandes diminuent ou qu’un fournisseur important met la clé sous la porte, bloquant la production, il faut pouvoir tenir jusqu’à l’amélioration de la situation. Le recours à l’activité partielle peut alors être une solution. Il s’agit d’un dispositif permettant à une entreprise de suspendre ou réduire temporairement le temps de travail de ses salariés, tout en les indemnisant et en bénéficiant pour cela d’une aide financière.
L’activité partielle : adaptabilité et flexibilité
« C’est un moyen d’éviter des licenciements. En cas de sous-activité, l’entreprise peut recourir à ce dispositif et réduire ses coûts puis repartir facilement lorsque l’activité se relance. Cela permet une plus grande adaptabilité », souligne Christian Rotureau, expert-comptable chez AEC Conseils et comptabilité, membre du groupement France Défi. L’activité partielle permet ainsi de conserver des compétences clés pour l’entreprise.
VIE: un dispositif RH intéressant pour les PME?
Si les petites et moyennes entreprises peinent encore à exporter, le Volontariat International en Entreprises (VIE) permet de lever les freins au développement à l’étranger. Un dispositif avantageux qui séduit de plus en plus de PME.
Instauré en mars 2000, le Volontariat International en Entreprise permet à des jeunes âgés de 18 à 28 ans d’effectuer une mission à l’étranger auprès d’une entreprise française d’une durée de 6 à 24 mois, renouvelable une fois sur cette période. L’objectif ? « Permettre aux entreprises d’aller à la conquête de nouveaux marchés en favorisant l’emploi d’un jeune. C’est gagnant-gagnant », note Arnaud Ruff, expert-comptable en charge du pôle international du cabinet Ruff et Associés, membre du groupement France Défi. Selon Business France, l’agence nationale chargée du développement des exportations et des investissements internationaux en France, les PME sont aujourd’hui les plus nombreuses à avoir recours au VIE: 66% en 2018 contre 44% en 2001.
S’implanter en zone de revitalisation rurale: quels avantages?
S’installer dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) permet à une entreprise de bénéficier d’un régime temporaire d’exonérations fiscales et d’exonérations de cotisations sociales, sous certaines conditions.
Depuis le 1er juillet 2017, un nouveau périmètre des zones de revitalisation rurale est entré en vigueur. Certains communes sont sorties de la liste, d’autres ont fait leur entrée. L’enjeu est loin d’être anecdotique. Ce dispositif, dont l’ambition est de lutter contre la désertification rurale, offre des avantages fiscaux aux entreprises qui s’implanteraient avant le 31 décembre 2020 sur un de ces territoires ciblés comme fragiles. « L’activité doit être nouvelle ou être une reprise d’entreprise existante dans la zone, prévient en préambule Romain Hocevar, expert-comptable au sein du cabinet Audit Gestion Conseil, membre du groupement France Défi. On ne peut pas simplement déplacer ou transférer ses bureaux pour bénéficier d’exonérations. Le législateur a mis des garde-fous pour faire respecter l’esprit du texte : aider au dynamisme des territoires. »
Travail à temps partagé: une solution pour ma PME?
Pour se développer, les petites entreprises ont besoin de compétences qu’elles ne peuvent pas toujours s’offrir. Le travail à temps partagé, qui permet de bénéficier d’une expertise sans avoir à embaucher un salarié à temps plein, peut constituer une solution.
Actuellement, Pierre Vergnaud travaille simultanément dans deux entreprises. « J’y occupe les fonctions de directeur des ressources humaines », explique ce professionnel chevronné, passé par de grandes groupes industriels. Il y a huit ans, il a décidé de devenir DRH à temps partagé et travaille, selon les périodes, dans deux à quatre entreprises en même temps. « Je suis trois jours par semaine dans une PME de 300 personnes où, comme n’importe quel autre DRH, je pilote les dossiers formation, relations sociales, négociations salariales ou comité d’entreprise », raconte-t-il.
Le congé création ou reprise d’entreprise: comment ça marche?
50% des Français considèrent qu’être chef d’entreprise est le choix de carrière le plus intéressant selon les résultats de l’Indice Entrepreneurial Français 2018 réalisé par l’Agence France Entrepreneur. Le congé création ou reprise d’entreprise permet aux salariés de préparer cette nouvelle vie d’entrepreneur.
Pour un salarié, se lancer dans l’aventure entrepreneuriale représente nécessairement une prise de risque. Le congé création ou reprise d’entreprise vise à faciliter cette expérience en lui permettant de prendre du temps, par le biais d’un congé ou d’une mise à temps partielle, pour se consacrer à son projet, tout en conservant la possibilité, à terme, de réintégrer son poste.
Donation de titres avec réserve d’usufruit: comment l’organiser?
S’il peut être difficile d’envisager l’avenir de son entreprise après sa mort, y réfléchir à l’avance permet, selon les aspirations du chef d’entreprise, de mettre en place des outils avantageux, comme la donation de titres avec réserve d’usufruit.
Parmi les multiples options qui s’offrent au chef d’entreprise pour transmettre son entreprise, figure en bonne posture la donation de titres avec réserve d’usufruit. « Cela permet d’anticiper la transmission de l’entreprise et d’en réduire le coût fiscal », résume Gonzague Omez, directeur juridique associé chez Efficience, membre du groupement France Défi.
L’opération consiste à effectuer la donation de la nue-propriété des titres de l’entreprise tout en en conservant l’usufruit.
Les donataires, nus-propriétaires détiennent juridiquement la qualité d’associé tandis que l’usufruitier a vocation à percevoir les fruits de ces titres, soit essentiellement les dividendes. Ainsi le ou la chef d’entreprise peut donner la nue-propriété de ses titres à son successeur, tout en gardant la possibilité de percevoir les dividendes, donc un revenu, jusqu’à sa mort
Gonzague Omez