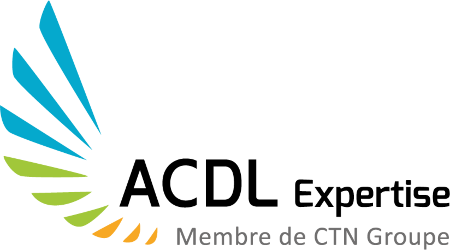Passer en société: l’arrêté des comptes
Passer en société: l’arrêté des comptes
Pour passer d’une entreprise individuelle à une société, il faut franchir plusieurs étapes . A commencer par l’arrêté des comptes. Décryptage sur un point essentiel pour le changement de forme de l’entreprise.
Le choix de la transformation d’une entreprise individuelle en société doit être mûrement réfléchi. Sa mise en œuvre suppose d’anticiper différentes opérations. L’arrêté des comptes de l’entreprise est un des moments forts de cette transition. Cette opération réalisée chaque année permet de photographier la situation patrimoniale et financière de l’entreprise. L’arrêté des comptes revêt une dimension particulière à la date du passage en société puisqu’il détermine précisément les actifs et passifs qui seront transmis à la nouvelle structure.
Passage en société: déterminer les meilleures options
Passage en société: déterminer les meilleures options
Le passage d’une entreprise individuelle en société nécessite d’examiner différentes options juridiques, sociales ou fiscales. Mode d’emploi pour prendre les bonnes décisions.
Transformer son entreprise individuelle peut répondre à différents objectifs, patrimoniaux, fiscaux ou économiques. Mais pour s’assurer d’y parvenir, encore faut-il faire les bons choix parmi les différentes options juridiques, sociales et fiscales disponibles. « On ne peut pas créer une société sans avoir une réflexion sur tous ces points-là», prévient Stéphane Duhaze, du cabinet Roosevelt et associés, membre du groupement France Défi.
La forme juridique sera ainsi fonction de différents paramètres et notamment du projet de l’entrepreneur. « S’il prévoit d’avoir recours à des investisseurs, la SAS pourra être privilégiée parce qu’elle permet d’aménager les droits de vote et les droits financiers », illustre l’expert-comptable. La souplesse variable des différentes formes de société peut aussi être un critère de choix. Opter pour une SARL, c’est bénéficier d’un cadre prédéfini avec des statuts types fixés par la loi. « Pour une SAS, les choses sont plus complexes. On a totale liberté dans la rédaction des statuts mais cela suppose de bien y réfléchir pour ne pas se retrouver, par exemple, avec un mode de gouvernance inadapté. Il ne faut pas oublier non plus qu’on peut faire évoluer la forme de la société dans le temps : commencer par une SARL puis passer en SAS lorsque cela sera vraiment adapté au projet», souligne Stéphane Duhaze.
Les formalités du passage en société
Passer d’une entreprise individuelle en société nécessite certaines formalités. Mode d’emploi pour que la transition se fasse sans problème.
Dernières étapes permettant de concrétiser le passage d’une entreprise individuelle en société : la création de la nouvelle structure et l’officialisation de l’arrêt d’activité de l’entreprise initiale supposent l’accomplissement de différentes formalités. « Pour gagner du temps et éviter les erreurs, l’entrepreneur a tout intérêt à se faire accompagner par des professionnels comme les avocats ou les notaires spécialisés en droit des affaires ou le service juridique de son cabinet d’expertise-comptable », conseille Christophe Bréchet, du cabinet SECAR, membre du groupement France Défi.
La création de la société suppose ainsi d’en rédiger les statuts, de bloquer, le temps de la création, le capital auprès d’une banque, de publier une annonce légale et de la faire immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés en envoyant le dossier de constitution auprès du Centre de Formalités des Entreprises dont dépend l’activité. « Lorsque l’on crée une SAS, la rédaction des statuts étant libre, les conseils d’un professionnel doivent permettre de prévoir les clauses spécifiques adaptées au projet. S’il y a plusieurs associés, on peut aussi rédiger un pacte d’associés, pour fixer les règles du jeu et déterminer la manière dont on s’organise », souligne l’expert-comptable.
Le prévisionnel: valider et sécuriser son passage en société
Vérifier la durabilité de son projet de passage en société est primordial. Pour la déterminer, l’entrepreneur peut se reposer sur le prévisionnel. Focus sur cet outil indispensable.
Transformer son entreprise en société, ce n’est pas qu’un changement juridique. Afin de vérifier la viabilité économique de son projet et se donner des outils pour surveiller sa réalisation, il importe donc d’élaborer un prévisionnel. « Cela permet d’analyser les conséquences des éventuels changements de statut social ou de régime fiscal lié au passage en société sur les résultats futurs et, dans le cas où cette transformation répond à un objectif de développement de l’activité, de valider le fait que la rentabilité sera bien là », explique Emmanuel Gauzy, du cabinet Gauzy, membre du groupement France Défi.
PME: comment réaliser une bonne étude de marché?
PME: comment réaliser une bonne étude de marché?
Pour établir ou ajuster la stratégie de sa société, le chef d’entreprise peut s’appuyer sur une étude de marché. Cet outil lui permet de mieux mesurer les investissements à mettre en œuvre.
Vérifier l’opportunité de lancer une entreprise ou un produit, évaluer son chiffre d’affaires prévisionnel, crédibiliser sa démarche auprès de partenaires financiers ou commerciaux… L’étude de marché peut remplir plusieurs objectifs. Outil précieux de l’entrepreneur, elle lui permet de réduire les risques d’échec de son projet. Pour le guider efficacement dans ses choix, elle doit analyser les tendances du marché, les besoins et les demandes de la clientèle, l’offre des concurrents mais également tenir compte de l’environnement économique, technologique ou législatif.
Réaliser son étude de marché en interne, n’est pas mission impossible. Si le chef d’entreprise délègue la conduite de celle-ci à ses commerciaux par exemple, son implication est néanmoins fondamentale. Maîtriser les informations concernant l’environnement commercial lui permettra d’être plus performant dans la gestion de son activité. Besoin d’aide ? L’Agence France Entrepreneur a réalisé une feuille de route à destination des dirigeants pour les guider dans la conduite d’une étude de marché.
Le portage salarial: une alternative à la création d’entreprise
Devant le besoin de flexibilité du marché du travail, le portage salarial qui offre une couverture sociale aux travailleurs freelance est amené à gagner du terrain.
A une époque où les entreprises doivent composer avec des carnets de commande fluctuants, elles sont amenées à privilégier la sous-traitance de missions ponctuelles plutôt que l’embauche. Pour ces collaborateurs éphémères, il est de coutume d’opérer sous le statut d’indépendant ou d’auto-entrepreneur. Mais il existe une troisième solution, pas toujours très connue : le portage salarial. “En 2016, 70 000 personnes ont fait appel au portage, pour un chiffre d’affaires global de 700 millions d’euros. C’est une hausse importante”, note Hubert Camus, président du syndicat des Professionnels de l’Emploi en Portage Salarial (PEPS).
Prestataires ou salariés? Attention à la requalification!
Pour éviter les contraintes liées au contrat de travail, certaines sociétés recourent à des travailleurs considérés comme des prestataires, mais traités dans les faits comme des salariés. Un choix particulièrement dangereux.
Les revendications des chauffeurs de VTC et des livreurs à vélo de commandes de repas mettent régulièrement sous les feux de l’actualité la question de la requalification des collaborations indépendantes en contrat de travail. Un risque concernant notamment les contrats passés avec des auto-entrepreneurs qui peut coûter cher. « Une entreprise considérée comme l’employeur d’un de ses prestataires devra en effet régler à ce dernier les congés payées, les heures supplémentairesmais aussi les charges sociales liées aux sommes versées, désormais considérées comme des salaires », explique Stéphane Finore, consultant RH au sein du cabinet d’expertise comptable Acofi, membre du groupement France Défi. Et la facture peut encore grimper si, entre temps, la collaboration a été rompue. « L’employeur devra alors verser l’indemnité de licenciement, celle du préavis, mais aussi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse », souligne Nicolas Béziau, avocat au sein du cabinet Ipso Facto à Nantes. Pire, si le cas est assimilé à du travail dissimulé, l’affaire peut être jugée au pénal, avec une amende à la clé pouvant aller jusqu’à 225 000 € pour les personnes morales et des dommages et intérêts s’élevant de manière forfaitaire à l’équivalent de six mois de salaires.
Entreprises: libérées d’accord, mais de quoi?
Comment s’organiser au mieux ? Pas une entreprise qui, à un moment de son existence, ne se pose cette question cruciale. A la clef, tenter d’obtenir l’organisation la plus efficace c’est à dire la plus productive mais aussi celle qui satisfera au mieux au bien être de ses collaborateurs. Focus sur la philosophie des entreprises libérées.
L’idée court depuis quelques années et fait de plus en plus d’émules : il faut libérer l’entreprise ! Certes, mais la libérer de quoi ? Et comment ? Thématisée par Isaac Getz, professeur de leadership et d’innovation à ESCP Europe, et Brian M. Carney dans Liberté et Cie, Quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises (Fayard, 2012), le concept d’ « entreprise libérée » décrit une forme organisationnelle de l’entreprise s’affranchissant des modèles de gouvernance classique. Et pour cause ! Voici comment les deux auteurs identifient le principal principe de l’entreprise libérée : les salariés sont totalement libres et responsables des actions qu’ils jugent bonnes d’entreprendre pour le bénéfice de l’entreprise.
Réussir une campagne de crowdfunding
Le financement participatif constitue un moyen intéressant de diversifier les ressources d’une association. C’est une réelle opportunité à condition de bien savoir préparer sa campagne.
Une constante progression
Le financement participatif est avant tout une expérience de capital social partagé qui se décline sous trois formes : le don, le prêt et le capital. En 2016, 2,5 millions de Français ont financé près de 21 375 projets et l’ensemble des fonds collectés a atteint 233,8 millions d’euros. Les plateformes de dons, avec ou sans contreparties, sont les plus nombreuses : 68,6 millions d’euros ont été collectés pour les dons (contre 50,1 millions d’euros en 2015) soit une hausse de 37 %. Le secteur associatif préfère recourir aux dons sans contrepartie et représente 85 % de ce type de campagne (contre 51 % des campagnes de dons avec contrepartie).
Le Haut Conseil à la vie associative dresse son second bilan
Le Haut Conseil à la Vie associative (HCVA) a rendu public son second bilan de la vie associative. Tous les deux ans, celui-ci permet de prendre la température du secteur et d’en dresser un panorama détaillé. Cette seconde édition consacrée aux années 2015 et 2016 a pour thème : « L’association au cœur de l’intérêt général ».
Le Haut Conseil à la Vie associative, haute instance composée de 30 « sages » qui connaissent parfaitement le secteur, commence son rapport en rappelant ce qu’est l’intérêt général et comment, concrètement, les associations y contribuent d’un point de vue social, économique et démocratique. Après une présentation générale, agrémentée de témoignages d’acteurs et d’associations engagées dans une démarche d’intérêt général qui illustrent la pluralité de cette notion trop souvent reléguée à sa dimension fiscale, le rapport s’engage à dresser le bilan des deux années passées.